Crise ivoirienne et lignes de failles

L’exacerbation récente de la crise ivoirienne, au lendemain du deuxième tour des présidentielles, s ‘est, non seulement imposée au débat dans l’ensemble de la communauté subsaharienne francophone, mais elle a aussi produit de curieuses lignes de fracture en son sein. Dans mon entourage, difficile de prévoir les positions de ceux sur qui, connaissant les idées socio-politiques, je croyais pouvoir parier. De façon générale, les sorties de ceux qui jouissent d’une visibilité et qui bénéficient potentiellement d’une audience, ont plus d’une fois déjoué les attentes a priori.
Ainsi de la Française – comme elle l’a elle même précisé dans sa lettre (1) à Béchir Ben Yahmed (BBY)- Calixthe BEYALA, la très conventionnelle BEYALA, très récente candidate au secrétariat de la très aliénante et bien futile Organisation Internationale de la Francophonie, y est-elle allée de son soutien au président Laurent GBAGBO. Ne se privant pas au passage d’une charge appuyée contre la françafrique. Dans sa réponse donc à BBY, on apprend qu’elle écrit en toute amitié à celui vis-à-vis duquel l’unique divergence antérieure se rapportait au choix de ce dernier d’affubler du suffixe « l’Intelligent » son hebdomadaire de communication : « Jeune Afrique ». Un avis sur un choix de lifting, une décision esthétique. Pas sur le positionnement éditorial d’un organe de publireportage qui entretient avec la françafrique des rapports de bénéfice réciproque.
Au Cameroun, le pays d’origine de la très gaulloise BEYALA, Hubert MONO NDZANA (2), un intellectuel du cru qui en d’autres circonstances s’est prostitué intellectuellement pour l’immoral régime BIYA (insigne doyen des dictateurs de la françafrique), n’a pas pu s’abstenir d’apporter lui aussi son soutien à la « décontraction » de KOUDOU. Au nom de la même résistance au néo-colonialisme.
Si l’évidente contradiction de ces deux personnalités est surprenante, les failles que l’on note au sein des milieux progressistes et intellectuels africains le sont encore plus (3). Au Cameroun toujours, le soutien de partis progressistes s’assumant comme tel à GBAGBO ne s’est pas fait sans dissensions en leur sein. Certaines tensions ayant conduit à des démissions au sein de ces groupes politiques.
Marketing médiatique :
« La communauté internationale » est acteur majeur de ce qui se passe actuellement en Côte d’Ivoire et surtout de ce qui risque de s’y dérouler.
A la manière dont l’industrie musicale fait souvent des tubes de piètres productions musicales, cette nébuleuse, qui épouse toujours les contours des intérêts occidentaux a élaboré - dès la proclamation hors délai et irrégulière des résultats du deuxième tour des dernières présidentielles ivoiriennes par la Commission Electorale Indépendante (CEI) – et martelé le refrain par lequel elle entend justifier toutes actions qu’elle jugera nécessaires à l’encontre du Président Laurent GBAGBO. La technique marketing consiste à assommer les auditeurs, à longueur de journées au rythme de bulletins d’information et de parutions des titres presse, d’un même refrain de non-dits. Mots clés:
- Le « président légal selon la déclaration d’un Conseil Constitutionnel (CC) » dont le président lui « est proche »/ « acquis ». Le président sortant qui « s’accroche au pouvoir depuis 2005 date de la fin de son mandat » ;
- Le candidat de l’opposition, « président déclaré par la Commission électorale indépendante » ; « le président reconnu par la communauté internationale » ;
- L’ONU a « certifié la validité du scrutin » ;
- « L’Union Africaine (UA) et la CEDEAO reconnaissent le vainqueur de la CEI » ;
Ce que laisse entendre ce refrain, c’est qu’un homme, Mr GBAGBO, dans le rôle d’anti démocrate, refuserait de reconnaître la victoire d’un adversaire qui lui, serait épris de démocratie. Et c’est à force de non-dits que cette représentation est construite.
Ce que ne dit pas ce refrain, dont les journalistes occidentaux dans leur écrasante majorité s’accommodent - par paresse, mépris ou en toute conscience du parti-pris - , c’est que dans tous les systèmes qui ont opté pour ce dispositif, le CC est toujours présidé par un proche du chef de l’Etat, puisqu’il est nommé par lui. Ce qui n’est pas dit, c’est que la CEI parée pour la circonstance de toutes les vertus était aux deux tiers favorable à OUATTARA. En taisant que la décision du CC est fondée sur des recours portés par les partisans de GBAGBO, on fait passer auprès de l’opinion publique internationale celui qui a consacré le plus clair de son existence à l’émergence des libertés en Côte-d’Ivoire pour un antidémocrate, un dictateur, une brute sans raffinement politique. Le président « reconnu par la communauté internationale » - entité aussi peu démocratique que brumeuse - apparaissant par contraste paré des vertus inverses.
La « reconnaissance par la communauté internationale » comme la « certification par l’ONU » qui va de pair passent pour attestation démocratique – niée à une partie, décernée à l’autre. Pourtant quand on sait que cette « communauté internationale » reconnaît aussi Denis SASSOU NGUESSO, revenu au pouvoir à la fin du siècle dernier par une guerre civile meurtrière à laquelle la France participa activement via Elf…
Quand on sait que cette chère « communauté internationale » reconnaît depuis 25 ans un tueur nommé COMPAORE - qui n’est d’ailleurs pas inactif dans la crise ivoirienne et qui s’est récemment proclamé vainqueur à plus de 80% de la dernière mascarade électorale qu’il a mise en scène
Quand on sait qu’à contrario cette même « communauté internationale » a mis sous embargo les populations de Gaza au motif qu’en se prononçant massivement en faveur du Hezbollah au cours d’élections ne souffrant d’aucune contestation sur la transparence de leur organisation, elles avaient mal choisi et méritaient dont d’être punies
Quand on sait tout çà, la « reconnaissance » par cette brumeuse communauté cesse d’apparaître comme un label de la qualité démocratique mais au contraire marque d’une étiquette douteuse – du moins en certains points du globe – ceux qui en sont bénéficiaires. Dans le cas de la Côte-d’Ivoire, la répétition fréquente de cette reconnaissance agit surtout comme rappel de et mise en garde contre la capacité de violence de ceux qui se cachent derrière le concept. Violence mettant au pas des chefs d’Etats souverains, les enjoignant de déposséder de signature, en toute illégalité, le chef d’un autre Etat tout aussi souverain. Violence retirant leurs créances aux ambassadeurs légaux pour les octroyer à d’autres. Violence qui manœuvre en coulisse pour une déflagration armée qu’elle se dit prête à appuyer.
Ce que ne dit pas le refrain, c’est que le champion de la « communauté internationale », jadis premier ministre d’un régime dictatorial batailla ferme contre l’instauration de la démocratie dans le pays. N’acceptant que du bout des lèvres l’instauration du multipartisme, il crut verrouiller le système en ne concédant que des élections multipartites à un seul tour. Dispositif qui aboutit à l’élection surprise (en apparence) en 2000 de Monsieur GBAGBO à la présidence de la République avec un score d’environ 20% sur lequel il se fonda pour contester un vainqueur qualifié à l’époque de « mal élu ».
Ce que ne dit pas le refrain, c’est qu’une commission électorale n’est qu’un organe administratif ad hoc qui a charge d’organiser et d’assurer le bon déroulement d’une élection et d’en compiler les résultats qu’il appartient, une fois accompli ce travail d’exécution et pour autant qu’il se déroule dans le temps imparti, au CC d’en entériner les résultats après prise en compte les éventuels recours. Dans des pays où le fonctionnement normal des dispositifs régaliens le permet, ce rôle administratif relève du ministère de l’intérieur ou de l’administration du territoire. La nécessité des CEI en Afrique signifie en fait l’échec du fonctionnement normal de l’Etat – notamment des dictatures comme celle d’Houphouët BOIGNY dont OUTTARA fut premier ministre.
Ce que ne dit pas le refrain, c’est que le pays dont il est question vit de fait une réalité de partition depuis 2002 avec l’intrusion d’une rébellion armée. Que la prétendue « communauté internationale » eût tôt fait, par les manœuvres de son éditorialiste (qui rédige des résolutions onusiennes que son armée a charge de « faire respecter sur le terrain ») et porte-parole dès lors qu’il s’agit de la françafrique – la France –, de légitimer ces criminels attaquant un régime démocratiquement élu en les conviant à la signature, au même titre que les autorités légales, des accords dits de Marcoussis. Accords qui constituèrent la première tentative de la « communauté internationale » à substituer à la constitution d’un pays des textes sans légitimité qui tenaient d’abord compte des intérêts du pays hôte. Le premier point de ces intérêts étant de remettre au plus vite en selle son jockey : Allassane OUATTARA. Que de cette partition de fait découle le délai de cinq ans entre la fin officielle du premier mandat de GBAGBO et la tenue de nouvelles élections présidentielles. Que malgré ce délai il eût été préférable d’attendre d’abord que les criminels tenant le nord du pays fussent désarmés. Tâche dévolue à la « communauté internationale » et à laquelle elle a failli lamentablement. Que par voie de conséquence, l’opposition des criminels des forces rebelles à tout contrôle des élections dans la partie nord du pays par des observateurs est à l’origine des doutes – pour dire le moins – sur le déroulement de ces élections dans les deux tiers septentrionaux du pays.
Ce que ne dit pas le refrain, c’est que l’aptitude de l’ONU à l’impartialité fait rigoler dans les cercles qui s’intéressent à son action et à son personnel ad hoc qu’on affuble du surnom de touristes électoraux, parce que leur action se déploie en général dans les parages d’hôtels de luxe où ils installent habituellement leurs quartiers généraux. Que dans le cas ivoirien en l’occurrence ils se sont bien abstenus de résister aux menaces des criminels du nord. Que des voix encore tenues s’élèvent relatant tel groupe d’observateurs de l’Union Européenne pris en otage dans la même partie du pays. Que les seuls observateurs qui aient eu le courage de se risquer dans l’enfer du nord de la Côte-d’Ivoire sont des observateurs africains de l’Union Africaine (qui dans un bel exercice de dépendance à la « communauté internationale » ne tient pas compte du travail de ceux-ci) rapportent des pratiques accablantes contre les partisans de OUATTARA qui contrôlent la rébellion. Tiens ! Ni la « communauté internationale » ni la presse occidentale n’informent le vaste public auquel ils ont accès de ce que notre cher financier ne fut pas seulement haut cadre du FMI mais qu’il est aussi le banquier de ces forces rebelles.
Ce que ne dit pas le refrain, c’est que ceux qui au nom de l’Afrique toute entière offrent le confortable couvert diplomatique sous lequel les nations riches et militairement puissantes interviennent en Côte-d’Ivoire, ceux de l’UA et de CEDEAO, se nomment bébé BONGO, bébé EYADEMA, Blaise COMPAORE et autres Denis SASSOU NGESSOU. Des personnages pas recommandables pour la majorité des africains. Le refrain ne dit pas non plus que ces organisations ne fonctionnement pas de façon démocratique pour ces questions ; se réunissant parfois en catimini pour adopter des mesures ne faisant pas l’unanimité. On entend par exemple pas assez que le Ghana et la Gambie, ont émis plus que des réserves sur certaines décisions de la « communauté internationale » entérinées par ces organisations. Tout comme le grand public ignore ce que pensent les dirigeants sud-américains ou asiatiques des positions qui leur sont implicitement attribuées sous le vocable de « communauté internationale ».
Post colonie. Acte II : l’insoumis :
L’issue de la crise ivoirienne est incertaine. Elle est sans doute porteuse de biens de tragédies. GBAGBO est-il panafricaniste ou bien mérite-t-il d’être considéré comme tel ? Le panafricanisme ou bien la lutte affirmée contre la françafrique suffisent-ils à soutenir un prétendant à la présidence ivoirienne ? Peu importe les réponses qu’on peut apporter à ces interrogations. Un fait est certain : cinquante ans après l’élimination ou le cantonnement (hors des processus décisionnels) des héros nationalistes des indépendances africaines, GBAGBO aura réussi l’exploit d’imposer le rôle de l’INSOUMIS au théâtre des rapports de la France vis-à-vis de l’Afrique. Jadis sous la seule responsabilité d’écriture de la France qui parlait en son nom propre et choisissait les acteurs de la partie africaine, la pièce s’est vue imposer depuis dix ans un personnage qui s’est arrogé le droit d’écrire ses propres textes et s’est entêté à essayer de définir son mouvement sur la scène. Trop longtemps la mise en scène n’a donné voix qu’au Seigneur et à ses vassaux. Au roi et aux roitelets. A l’Empereur et à ses satrapes. Toute possibilité de parole autonome étant confinée dans la figuration ou tue. En occupant le fauteuil qui était réservé à un laquais, en s’y maintenant dix années durant (dont deux seulement de gouvernement plus ou moins serein), il a obligé le rôle et écrit au jour le jour, à la crise, à chaque nouvelle accusation, chaque évocation de charnier, chaque nouvelle tentative d’éviction, la réplique séditieuse dont la « communauté internationale » a si souvent remis l’avènement en Afrique aux calendes grecques.
Pour ce faire, il lui a fallu résoudre l’une des failles tactiques qui explique bien des défaites avant lui : l’isolement. C’est en effet en coupant les nationalistes africains de leurs soutiens potentiels que, au Cameroun comme en RDC par exemple, les colons ont fragilisé UM NYOBE et LUMUMBA. GBAGBO au contraire, a su, à l’intérieur de la Côte-d’Ivoire au moins, convaincre un nombre seuil de personnes déterminées à défendre sa position. Le moment emblématique de cette solidarité est l’affrontement en 2004 de l’armée française contre des partisans (aux mains nues) du président, qui se solda par la mort d’au moins cinquante ivoiriens. Il a bien sûr tiré des leçons de ces précédents échecs mais a aussi su profiter des possibilités de communication que permettent les technologies informatiques modernes. On se souvient qu’alors que le France officielle et celle de ses médias « nationalistes » (l’ensemble des médias mainstream du pays) avaient dans un premier temps nié ce forfait, le gouvernement ivoirien avait patiemment, via internet, su faire émerger une autre vérité, LA VERITE, sur cet ignoble massacre. Consciente que GBABGBO n’est pas seul à l’intérieur, la France se voit aujourd’hui contrainte d’essayer d’organiser son isolement à l’échelle du continent.
Cette tentative patente de manipuler les organisations panafricaines exige de ceux qui en Afrique sont jaloux d’un devoir de révolte à organiser une résistance panafricaine pour contrer ces efforts de marginalisation.
(1) http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2607p018-019.xml2/
(3) http://www.madagascar-tribune.com/La-crise-ivoirienne-divise-les,15354.html

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F3%2F9%2F397030.jpg)


 Le titre acheté n’était pas celui que j’avais projetté d’acquerir.
Le titre acheté n’était pas celui que j’avais projetté d’acquerir. 
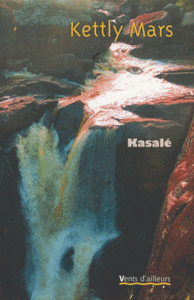 Gran va mourir. Antoinette alias Gran, la doyenne du lakou Kasalé va mourir. Cette convictiton que partage chaque personnage du roman dès les premières pages, le lecteur finit par l'adopter. C'est la chute du cachiman géant une nuit de gros temps - un arbre planté à la naissance de la doyenne - qui est porteuse de cet augure funeste. Présage que va renforcer l'effondrement, suite aux mêmes intempéries, du kay-mistè, le temple dédié aux dieux vaudou. L'aïeule qui toute son existence durant a été le véhicule des esprits sait mieux que quiconque la signification d'une telle conjonction malheureuse. Elle sait ses jours comptés et pourtant elle va s'assigner deux missions à réaliser avant sa mort: reconstruire le kay-mistè d'une part, trouver un successeur à son rôle d'oracle entre humains et esprit.
Gran va mourir. Antoinette alias Gran, la doyenne du lakou Kasalé va mourir. Cette convictiton que partage chaque personnage du roman dès les premières pages, le lecteur finit par l'adopter. C'est la chute du cachiman géant une nuit de gros temps - un arbre planté à la naissance de la doyenne - qui est porteuse de cet augure funeste. Présage que va renforcer l'effondrement, suite aux mêmes intempéries, du kay-mistè, le temple dédié aux dieux vaudou. L'aïeule qui toute son existence durant a été le véhicule des esprits sait mieux que quiconque la signification d'une telle conjonction malheureuse. Elle sait ses jours comptés et pourtant elle va s'assigner deux missions à réaliser avant sa mort: reconstruire le kay-mistè d'une part, trouver un successeur à son rôle d'oracle entre humains et esprit.  Kasalé est la narration des derniers jours de cet ancêtre. Une sorte de contre-la-montre avant de rejoindre le pays sans chapeau. Comment trouver un serviteur fidèle des loa dans le contexte particulier d’un pays où le christianisme, aidé par le pouvoir politique, a contraint à des retranchements ténus le vaudou, la spiritualité traditionnelle. Où au sein de la propre famille de Gran, le parent le plus proche, la nièce Nativita, est la zélote de la nouvelle foi la plus ouvertement opposée au vaudou.
Kasalé est la narration des derniers jours de cet ancêtre. Une sorte de contre-la-montre avant de rejoindre le pays sans chapeau. Comment trouver un serviteur fidèle des loa dans le contexte particulier d’un pays où le christianisme, aidé par le pouvoir politique, a contraint à des retranchements ténus le vaudou, la spiritualité traditionnelle. Où au sein de la propre famille de Gran, le parent le plus proche, la nièce Nativita, est la zélote de la nouvelle foi la plus ouvertement opposée au vaudou.









